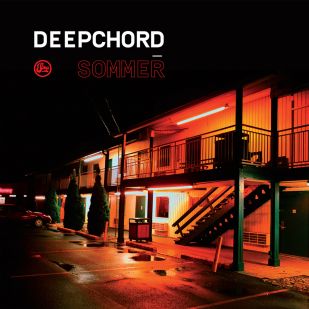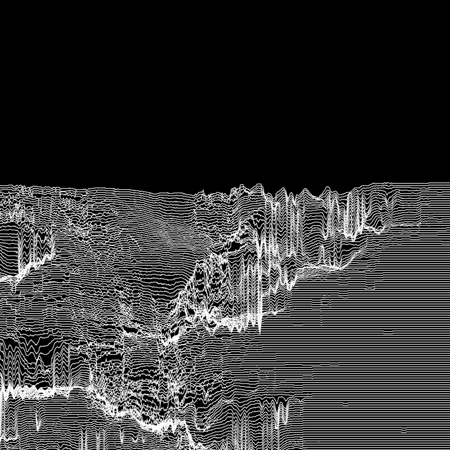Sortie : août 2012
Label : Don't Cry Recordings
Genre : Jazz, Soul, R&B
Note : 8/10
Emmenée par le batteur virtuose Jamire Williams, la formation Erimaj connaît une certaine émulation depuis que le NY Times et d'autres organes de presse (généralistes comme spécialistes) ont salué avec fracas la richesse des compositions. Déjà sorti et acclamé l'année dernière, le single Conflict Of A Man a même été ajouté à la compilation inspirée Digging the Blogosphere. Un premier format court avait vu le jour en 2010 dans un questionnant silence (Memo To All). Confidentialité dont la coulissante formation new yorkaise ne pourra pas cette fois-ci profiter. Même si nous ne sommes pas coutumiers du jazz, aussi hybride soit-il, on ne va pas se priver de donner notre avis. Surtout à l'heure où Chroniques Electroniques connaît ses derniers soubresauts, avant que ne vous soit proposé un peu plus loin, un contenu toujours aussi fouisseur même si plus généraliste (ici). Parlons donc de cet excellent album avant que tous les autres n'en fassent leurs choux gras.
L'album fera sûrement hurler les puristes du jazz, et c'est tant mieux. Avant tout parce qu'il ne saurait se satisfaire de la certes très noble étiquette. Le son d'Erimaj se nourrit du meilleure de la musique noire américaine, plus pour rendre un hommage vibrant à la négritude que pour sonner réellement moderne. Et donc ne pas forcément réjouir ceux qui squattent devant MTV et Trace TV. Moderne ? Elle l'est, sans la moindre hésitation. La production est juste totalement implacable. Mais la spontanéité et la ferveur du jeu renvoie aux heures les plus roots des jams sessions qui sentaient bon la sueur, le sang et les larmes de studios enfumés et mal éclairés. Même si la tessiture très très haute et criarde de Chris Turner fait parfois évoluer l'ensemble dans des ambiances un peu plus électroniques, heureusement plus sexy et moites que complètement sirupeuses, la formation a puisé son essence dans la folie d'ovnis musicaux aussi adulés que crédibles comme Demon Fuzz ou Screamin' Jay Hawkins. Les amateurs de comparaisons plus scolaires, plus jazz et donc plus significatives, ne pourront qu'entrevoir les profondes influences de maîtres tels que Art Blackey et Herbie Hancock. Même si la corrélation vaut surtout pour les échappées plus modernes du dernier cité.
Dire que Jamire Williams a du bras et du groove est un doux euphémisme. Même si le génial batteur intervient ici en leader jamais martial, la place qu'il laisse aux géniales divagations des autres intervenants est assez exceptionnelle. Surtout quand on sait que le jazz n'est pas le premier terreau de l'humilité. Le gars a surtout compris que ses complices étaient loin d'être des noobs, même pour ce qui est des modulations un peu expérimentales et électroniques posées surtout sur les basses et les claviers. Le plus impressionnant réside dans la couleur et les contrastes apportés par les différents instruments. La parcimonie des cuivres de John Ellis d'abord, le jeu sur-vitaminé et peu orthodoxe du génial guitariste Matthew Stevens, mais surtout l'oscillation permanente de Jason Moran entre l'électricité du Fender et les textures plus classiques du piano. Voilà qui sans être probablement la volonté première, résonne comme un hommage moderne et libre à l'héritage des big bands d'antan et surtout à certains aspects (pas tous donc) de la révolution hard bop.
Pour adhérer à ce personnel et peut-être excessif constat, il ne faudra pas tomber en premier lieu sur les titres chantés, ou ceux dont Radio Nova n'a visiblement retenu que les aspects les plus "chill". Il faudra plonger oreilles grandes ouvertes dans les fresques et grandes réussites que sont les excellents et sinueux Unrest et Black Super Hero Theme Song, le rondement psychédélique Plants, le sens inné du groove lover d'un Conflict Of Man, qui n'a pas pris une ride et n'aurait rien à envier aux premiers travaux d'Amp Fiddler. Et ces foutues trois dernières minutes de Choosing Sides, où le saxophone et le piano se tirent la bourre comme jamais pour échapper aux contre-temps de la batterie et à la nappe cuivrée. Exceptionnel.
Conflict Of Man est une bien jolie friandise pour les oreilles, déployant un imposant arsenal technique et technologique. Il faudra malgré tout veiller à ne pas se laisser happer par ses parties les plus onctueuses, tendant ouvertement vers un R&B pas toujours du meilleur goût. Il y a largement de quoi faire ailleurs. Un disque recommandé, qui ne devrait pas tarder à faire grand bruit tant il est rassembleur.

par Ed Loxapac